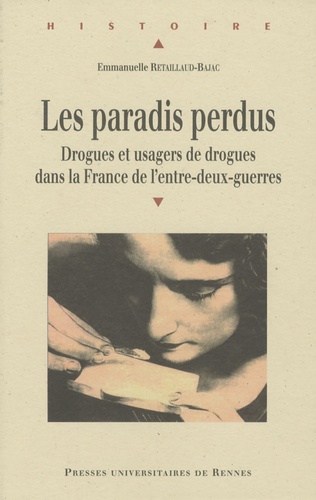 Emmanuelle Retaillaud-Bajac,
Les Paradis perdus. Drogues et usagers de drogues dans la France de l’entre-deux-guerres. Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2009, 467 pages. « Histoire ».
Emmanuelle Retaillaud-Bajac,
Les Paradis perdus. Drogues et usagers de drogues dans la France de l’entre-deux-guerres. Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2009, 467 pages. « Histoire ».Issu de sa thèse de doctorat, le livre d’Emmanuelle Retaillaud-Bajac prolonge chronologiquement le travail de Jean-Jacques Yvorel1. Ce dernier traitait des drogues en France au XIXe siècle et se refermait sur la loi de juillet 1916 qui initie leur pénalisation. Cette fameuse loi définit la catégorie des « stupéfiants » : l’opium et ses dérivés (morphine, héroïne), ainsi que la cocaïne et le haschich. Elle est avant tout dirigée contre les trafiquants et tenanciers de fumeries, qui encourent jusqu’à deux ans de prison. Vis-à-vis des consommateurs, elle se fait plus ambigüe. Elle se préoccupe de distinguer usage légitime (thérapeutique, dûment encadré par le corps médical) et l’usage à des fins de plaisir. Si, en théorie, la consommation de ces substances n’est pas un délit, la loi punit ceux qui « en auront usé en société » ou encore « auront été trouvés porteurs sans motif légitime » ce qui laisse dans les faits la porte grande ouverte à sa répression. Implicitement, la loi entérine le statut spécifique de l’alcool, de loin le principal psychotrope utilisé, mais qui n’entre pas dans son champ d’application. Pas plus au moment du vote de la loi que dans les deux décennies suivantes, la notion de « toxophilie » qui, avec l’alcool, engloberait tous les autres psychotropes, ne fera recette. La loi de 1916 a des implications considérables : inscrivant la drogue dans l’illicite, elle provoque la stigmatisation de la consommation ainsi qu’un renchérissement considérable. L’illégalité contribue à en détourner les élites sociales. Malgré la difficulté de travailler sur un sujet qui relève donc, selon une expression ramassée qui fait mouche, de « l’intime, [du] clandestin et [du] minoritaire », E. Retaillaud-Bajac parvient à ses fins en variant au maximum les sources utilisées : littérature, revues médicales, archives policières et judiciaires, en particulier. En matière de presse, elle a le mérite d’identifier avec beaucoup d’astuce un journal qui fait dans l’entre-deux-guerres le pari éditorial (gagnant) d’accorder une importance toute spéciale aux nouvelles et faits divers en rapport avec la drogue : Paris-Soir.
Le travail patient de l’auteur permet de montrer qu’en dépit d’une ampleur assez modeste, le phénomène des drogues s’inscrit durablement dans le paysage social de la France. Les estimations
qu’elle avance sont convaincantes et situent le nombre de consommateurs entre 1 000 et 15 000 individus, tous types d’usages et de produits confondus. Cet ordre de grandeur ne doit pas nous
dérober la variété du phénomène, depuis le médecin qui s’injecte en toute légalité de la morphine qu’il s’est prescrite, jusqu’au petit délinquant adepte de la « coco » en passant par
la demi-mondaine fumeuse d’opium, la consommation de drogues présente assurément de très nombreux visages. De plus, même si la période retenue est assez courte, elle n’est pas soluble en bloc
dans un « après-1916 », car travaillée par des évolutions significatives, en particulier le recul de l’opium au profit de la cocaïne, puis de l’héroïne. Même si, à travers une série de
portraits allant de Jean Cocteau à d’autres plus ou moins sombrés dans l’oubli, comme Joë Bousquet (1895-1950), E. Retaillaud-Bajac accorde une place considérable aux rapports entre drogue et
milieux artistico-littéraires, elle montre par ailleurs que le lien à la création artistique se distend. La drogue glisse plutôt vers l’interlope, le monde de la nuit et des plaisirs. La
géographie de la drogue, elle, s’avère assez stable et très parisienne. Montmartre se pose en épicentre de la consommation et du trafic. Les grands ports font, plus que d’autres villes de tailles
comparables, une place plus importante à la drogue. L’auteur s’intéresse à Marseille, qui n’est pas seulement un lieu de transit pour le trafic international mais aussi un centre de consommation.
La clientèle marseillaise s’avère plus populaire et moins marquée par la bohême qu’à Paris.
Autant que sa réalité sociologique, la perception de la drogue change. Les médecins, qui étaient largement à l’origine de la loi de 1916, conçoivent rapidement ses limites et ils voient de plus en plus dans le drogué un névrosé et non plus un débauché. Il faut soigner. Le livre contient des développements particulièrement précieux sur les structures et les différentes méthodes de sevrage (p 294-307). On apprend en particulier que le premier service spécialisé dans le sevrage des toxicomanes est organisé à l’hôpital Henri-Rousselle ouvert à Paris en 1922. Le grand public, lui, apprend grâce à la presse à associer consommation de drogues et délinquance, ainsi qu’à brocarder un personnage nouveau : le trafiquant.
Il est une pratique, trop tentante pour n’être pas fréquente, en particulier dans les travaux consacrés aux marges de la société. Elle consiste à prendre le contre-pied d’un « on a longtemps cru que », souvent complaisamment construit à sa main par celui qui s’assigne pour mission de le remettre en cause. L’un des mérites du livre est, précisément, de ne pas céder à un tel penchant. Effectivement, il pouvait paraître possible que la loi de 1916 rejetant les drogues dans l’illégalité, l’entre-deux-guerres représente une simple parenthèse de repli avant leur retour, inspiré de la contre-culture américaine, dans les années 1960. En montrant que, si la consommation ne marque que très relativement le pas et que la population des adeptes de la drogue, loin d’être forcément constituée de personnes entrées dans la « carrière » avant 1916, se renouvelle de façon assez constante, E. Retaillaud-Bajac suggère que le trait distinctif de la période est plutôt une certaine acclimatation. Celle-ci apparaît éminemment paradoxale, puisque c’est toujours sous l’apparence d’une altérité à la fois inacceptable et pourtant fascinante que les drogues sont reçues par l’immense majorité de la population : les Français prennent dès cette époque l’habitude de s’inquiéter de la « montée » de la consommation des drogues.
La réserve principale que l’on peut poser, si l’on passe sur coquilles et fautes d’orthographe, en nombre trop important, concerne certains aspects des transformations de l’offre. S’il est vrai que le titre même du livre laisse entendre que l’accent y est mis sur la demande et la consommation de drogues, il n’en reste pas moins regrettable que les premiers grands trafiquants ne soient appréhendés qu’à travers le regard porté sur eux par le grand public et les médias. On est en particulier un peu surpris de voir seulement énumérés (p 402), dans une même phrase et sans plus de détails, Otto Jauffman, « l’empereur des stupéfiants », Louis Lion, « le roi de la drogue » ou Fernandez Bascula, « le caïd de la drogue parisienne ». L’emprise nouvelle du grand banditisme international sur les circuits de la drogue n’est qu’à peine évoquée, alors même qu’il s’agit d’une nouveauté capitale de la période.
Cela ne remet nullement en cause la qualité du livre de Retaillaud-Bajac. Parfaitement maîtresse de la littérature savante, exploitant remarquablement ses sources, elle tire tout le profit du caractère éminemment transversal de son sujet pour apporter une importante contribution à plusieurs aspects de l’histoire de la France de l’entre-deux-guerres.
Xavier Paules1 J.-J. Yvorel, Les poisons de l’esprit, Paris, Quai Voltaire, 1992.
Pour citer
http://mouvement-social.univ-paris1.fr/document.php?id=1608.

/image%2F0535626%2F20201105%2Fob_776525_121486191-103977568156252-511899038425.jpg)